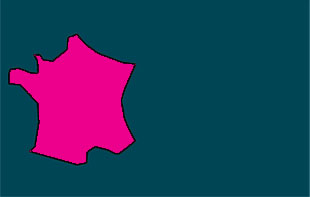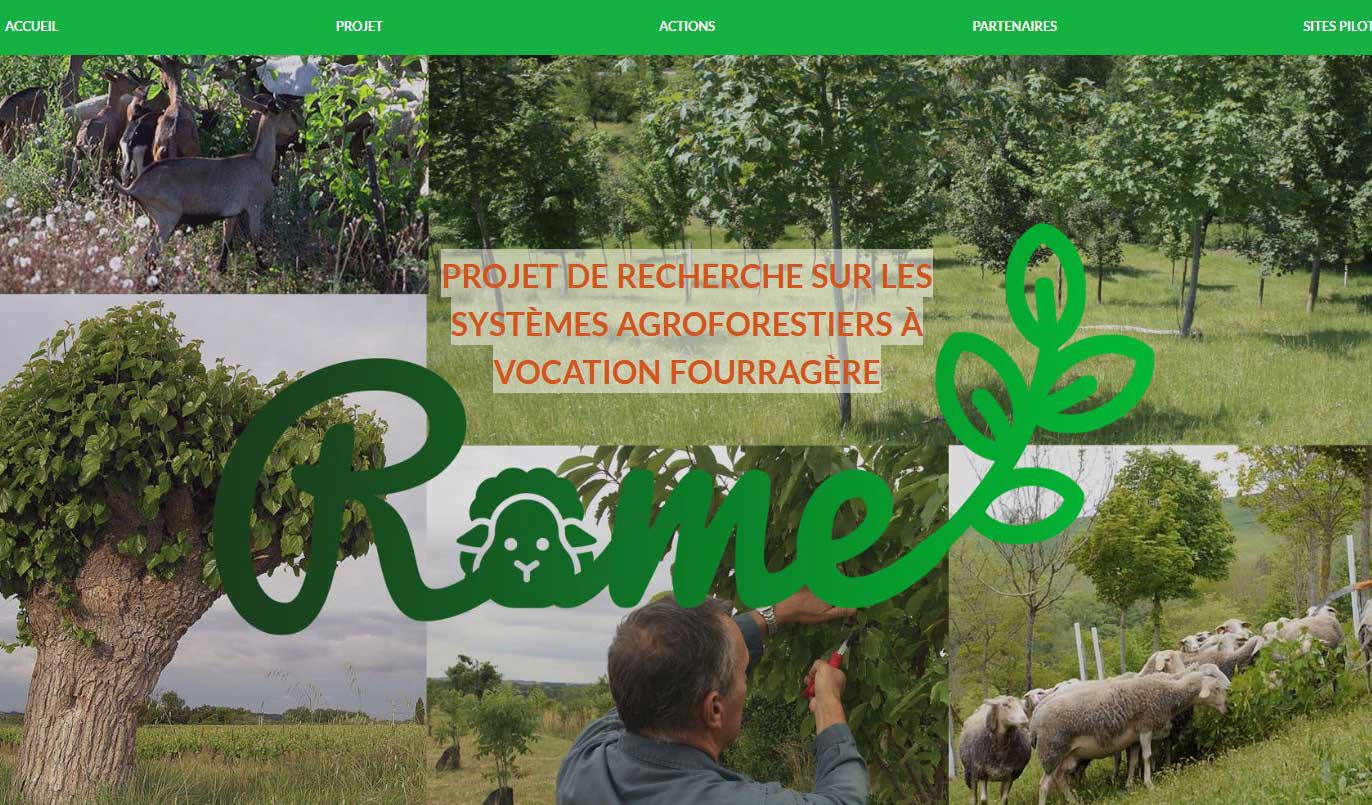La ressource fourragère tirée des arbres est encore peu étudiée et soulève des questions concernant l'éventail de leur valeur alimentaire, leur acceptabilité par les animaux, et les itinéraires de production. Les études scientifiques s’intéressant à la valeur alimentaire des feuilles de ligneux (arbres, arbustes ou lianes) sont encore peu nombreuses en Europe (e.g. Smith et al., 2014 ; Emile et al. 2017 ; Luske and Van Eekeren, 2018). Les recherches ont, jusqu’à présent, surtout concerné des fourrages ligneux caractéristiques des systèmes pastoraux de la zone méditerranéenne (Meuret, 1986 ; Mosquera-Losada et al., 2004 ; Papanastasis et al. 2008, Mebirouk-Boudechiche et al., 2015) zones tropicale (Alonso-Diaz et al., 2008 ; Vu et al., 2011). Le manque de références sur la valeur nutritive des essences d’arbre en milieu tempéré constitue un frein pour le développement de leur utilisation (Hermansen et al., 2015). Les premiers résultats obtenus dans le cadre des projets PARASOL et ARBELE et présentés dans Emile et al. (2017) sur les teneurs en matières azotées totales (MAT), fibres, tanins condensés (TANc) et digestibilité in vitro des feuilles de 27 espèces ligneuses, méritent d’être complétés en incluant de nouvelles essences et en considérant non seulement la feuille mais également les jeunes tiges ou brindilles aussi consommées par les animaux.
Bien que traditionnellement utilisé comme fourrage d’appoint en cas de sécheresse, il n’existe pas de tables de production des arbres hors forêt. En particulier, il n’y a pas de références sur les parties feuilles et rameaux, consommables par les animaux. La quantité produite dépend de l’arbre, de son âge, du contexte pédoclimatique et du mode de gestion (Colin et al., 2018). Des enquêtes menées auprès d’éleveurs lors des projets ARBELE et PARASOL (Béral, 2018), nous permettent d’approcher quelques notions de productivité et d’apport aux animaux. Ainsi, les mûriers dans le sud de la France peuvent apporter des compléments après les estives fin août et à l’automne (entre 10 et 20 % de la ration). Cependant il n’existe pas de tables de production pour les arbres recépés ou étêtés régulièrement par exemple, et pour la multitude d’espèces ligneuses pouvant être pâturées. Les questions essentielles sur le nombre d’arbres à planter ou à gérer ainsi que la prise en compte des besoins des animaux selon les périodes restent entières.
Territoires et sites pilotes
Le projet s’inscrit sur une diversité de territoires (Auvergne, Cévennes, Ain, Ariège, Ardèche, Vienne) concernés par des contextes pédoclimatiques et des pratiques d’élevage différentes. Sur la plupart d’entre eux, le frêne "émonde », ou le mûrier têtard est/était très présent sur les exploitations d'élevage, les exploitants coupant les branches feuillées pour nourrir les animaux les années de sécheresse (2003, 2011, 2015, 2016, 2017). Sur chacun de ces territoires, des dynamiques de développement et d’expérimentation (sites pilotes) sur l’arbre fourrager ont émergé et constitue le socle expérimental de RAME.
A partir de l’étude du potentiel fourrager des arbres, le projet a pour ambition de concevoir à l’échelle des fermes, des aménagements agroforestiers pour la production d’une ressource fourragère arborée permettant d’augmenter la résilience climatique et économique des systèmes d’élevage ruminants (ovins, bovins, caprins).
Les axes de recherche spécifiquement ciblés sont les suivants :
- Etude des pratiques et productivité fourragère des ligneux (Action 1) : L’objectif est d’étudier finement les performances technico-économiques de systèmes d’élevage intégrant pleinement les aménagements agroforestiers à vocation fourragère.
- Intégration dans la ration et performances animales (Action 2) : Il s’agit d’étudier les préférences alimentaires des ruminants vis-à-vis des ligneux et d’évaluer la qualité fourragère, l’ingestibilité de différentes ressources différenciées selon l’essence et les modes de conduite, et leurs effets sur les performances zootechniques (bovins, ovins et caprins).
- Pistes d’innovation et mise en place de sites expérimentaux participatifs (Action 3) : Notre objectif sera de favoriser des échanges entre éleveurs, chercheurs et techniciens pour partager les connaissances techniques et scientifiques et imaginer, chez des éleveurs intéressés, l’implantation de dispositifs fourragers à vocation expérimentale. Ces nouveaux sites, ainsi que d’autres dispositifs agroforestiers déjà implantés, contribueront aux perspectives de recherches participatives sur cette thématique.
- Partage de connaissances et savoirs-faires (Action 4) : Il s’agira à la fois d’assurer la visibilité du projet et de partager l’ensemble des résultats avec les acteurs de la filière. Une attention particulière sera accordée à l’échange et au partage de savoirs-faires et connaissances liées aux pratiques des éleveurs.